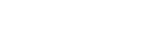Au Sahel, la France doit s'inventer une stratégie pour rester militairement efficace et politiquement influente.
Selon Stephen Smith, professeur d'études africaines à l'université Duke aux Etats-Unis: « La France doit vivre avec le reproche qu'elle est responsable du bilan des indépendances », écrivait-il mardi dans le quotidien Le Figaro. « Mais il lui reste à comprendre le paradoxe que sa responsabilité monte en flèche alors que son influence en Afrique se réduit comme peau de chagrin ».
Pour Jean-Hervé Jézéquel, directeur du Projet Sahel de l'organisation de résolution des conflits Crisis Group, « la France paie sa volonté de vouloir maintenir une présence politique et militaire très forte dans son ancien pré-carré ». « Au Sahel, les responsabilités sont sans doute partagées. Néanmoins, La France a joué un rôle de chef de file et doit donc assumer ses responsabilités ».
Katherine Zimmerman, experte du Sahel à l'American Enterprise Institute de Washington, note que les Français « font face à un problème d'accès » aux zones de prédation des groupes au Sahel, aggravant le défi déjà énorme de lutter contre des réseaux jihadistes profondément ancrés dans les enjeux politiques locaux.
LIRE AUSSI: Abidjan : une pinasse relient Abobo-Doumé au Plateau se renverse avec des passagers à bord
« L'armée française ne peut plus viser le coeur des réseaux au Mali et au Burkina. A la place, elle devra s'appuyer sur la Côte d'Ivoire, le Niger et le Sénégal pour limiter la propagation et contenir le problème », précise-t-elle à l'AFP, relevant que Bénin, Togo et Ghana, désormais inquiétés, peuvent aussi y contribuer en facilitant des opérations frontalières.
Mais ce qui apparaît en filigrane est bien le recul de l'espoir d'une solution militaire alors qu'il reste quelque 3.000 militaires français au Sahel, après un pic à 5.500 en 2020.